Les Sept de Chicago Inde, Royaume-Uni, Etats-Unis 2020 – 129min.
Critique du film
Procès de la pensée et humanité bâillonnée

Les Sept de Chicago fait partie de ces films qui, pourrait-on croire, sont maudits bien avant d’arriver en salles. Seulement écrit par Aaron Sorkis en 2007, il était supposé passer devant la caméra de Steven Spielberg avant d’être annulé suite à la grève des scénaristes. Et si des bruits de couloirs laissent supposer que Paul Greengrass et Ben Stiller pourraient prendre sa place, rien ne se fait… jusqu’en 2018, où Spielberg le ressuscite. Offert alors à son premier scénariste, le film est promis à une sortie cinéma classique. L’horizon visé est celui des élections présidentielles de 2020, mais il se prend de plein fouet la crise sanitaire mondiale… permettant à Netflix de se tailler à nouveau la part du lion.
Rejoignant les Roma d’Alfonso Cuarón, Irishman de Martin Scorsese, Mariage Story de Noah Baumbah ou encore, et plus récemment, Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, Les Sept de Chicago est de ces films tellement purement politiques qu’il pourrait repousser les spectateurs peureux de ne voir en lui qu’un simple argument militant. Racontant le procès odieux de ces huit hommes accusés entre autres de conspiration, d’incitation à la révolte et d’être responsables des émeutes qui ont pris Chigaco lors de la Convention démocrate de 1968, alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leurs droits le plus humain, leur liberté d'expression, il met à nu le revers d'un système judiciaire trop facilement corruptible. Une volonté politique de changer les choses.
Les Sept de Chicago n’est que le deuxième film d’Aaron Sorkis en tant que réalisateur qui, c’est peut-être la seule chose qu’on peut lui reprocher, se cache encore trop derrière ses talents de conteur, de scénariste et raconteur d’histoire. Dynamiques, parfois trop, cadencés et académiques, réalisation et montage ne resteront certainement pas dans les mémoires pour ce qu’ils ont à apporter au genre. Si la caméra est juste, et la construction jouant de flash-back habile, rien n’appuie vraiment les propos révoltants, gravissimes, et les injustices de son propos. Mais peut-être était-ce un choix délibéré du cinéaste, lui qui saupoudre avec parcimonie son film de quelques moments comiques, s’autorisant aussi la création d’un gimmick appréciable. Peut-être était-ce dans une volonté de laisser toute la place possible au talent des acteurs, à la densité de ses propos et à leur contemporanéité criante.
Car en cent vingt-neuf minutes, Sorkis se permet de balayer un spectre de questionnements et de considérations politiques et sociaux énormes, allant du racisme systémique à la corruption de la justice américaine en passant par de la toute-puissance de la figure du juge… le tout sur fond de lutte révolutionnaire et de réflexions sur les moyens mis en œuvre pour arriver à ses fins. C’est ce foisonnement primordial qui réussit à donner tout son élan émotionnel au film, à impliquer le spectateur dans ce qu’il a de plus intime: sa volonté de justice. Son incapacité de ne pas se révolter lorsque ce droit lui est nié.Qui du jeune premier blanc nanti pacifiste, du hippie rêvant de balayer de sa révolution culturelle les modes de vie capitalistes ou de l’opprimé afro-américain, peut le plus légitimement porter les couleurs de la révolution en marche? Comment porter ses idées, leur faire traverser les époques et ne pas les desservir? Comment répondre devant la justice d’actes que l’on n’a pas commis, quand le procès est politique, quand on nie notre humanité? Depuis quand est-ce devenu la norme d’être jugé pour ses idées?
Il aura au moins fallu un Sasha Baron Cohen, un Eddie Redmayne, un Yahya Abdul-Mateen II, un Mark Rylance ou encore un Frank Langella pour porter avec autant de brio des questions aussi importantes. Aussi actuelles dans la fluidité de notre contexte social, naviguant toujours entre prise de conscience mondiale, actes abominablement racistes et campagne présidentielle particulière.
Votre note
Commentaires
“Toujours le poing levé”
Suite aux émeutes qui déchirèrent Chicago en 1968, sept activistes sont arrêtés. Considérés comme les organisateurs des manifestations, ils sont accusés à tort de conspiration. Bobby Seale, cofondateur du Black Panther Party est également jugé à leurs côtés, « pour l’exemple ». Affublée de différents costumes, c’est la « gauche radicale » qui est appelée à la barre.
Le procès qui débute a tout d’une farce : un juge acariâtre qui porte le même nom que l’un des prévenus, dont certains se travestissent en magistrat ; un avocat aux abonnés absents ; des policiers espions qui ravissent le cœur des militants fleur bleue… Faites l’amour, pas la guerre au Viêt Nam ! Les objections fusent tout comme les dialogues acérés du génial Aaron Sorkin. Pas le temps de s’ennuyer devant ce plaisant plaidoyer. Mais au fil des nombreux jours qui s’enchaînent, l’espièglerie laisse place à la gravité. Les images d’archives se mêlent à la reconstitution. Oppression, mensonges, partialité crasse, corruption, violences policières, racisme… L’Amérique divisée d’hier de Nixon ressemble furieusement à celle d’aujourd’hui. L’écho « Je ne peux pas respirer » se fait entendre dans la douleur. Et quand sous ce barnum, en dépit du spectacle, le pays finit par compter ses morts, on se prend à lever un poing imaginaire, plein d’amertume.
(8/10)… Voir plus
Dernière modification il y a 3 ans
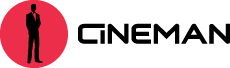

















Vous devez vous identifier pour déposer vos commentaires.
Login & Enregistrement